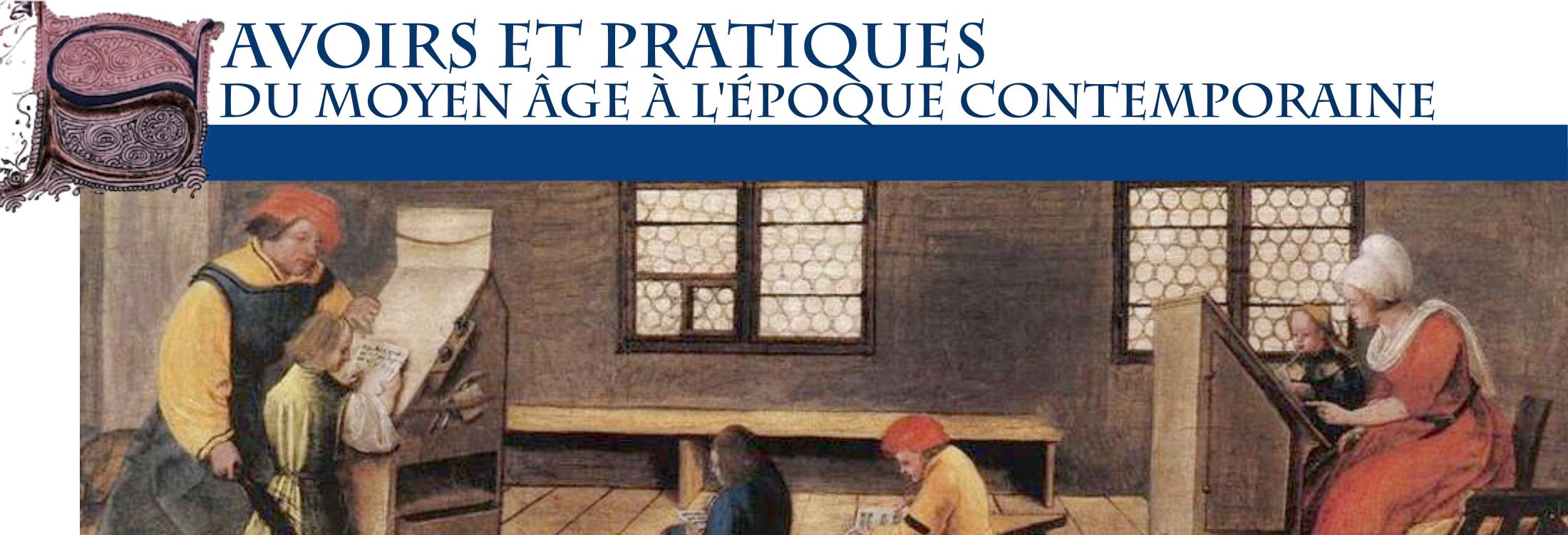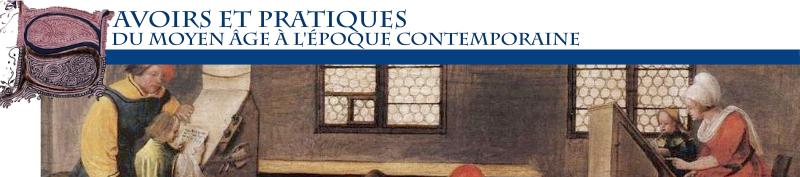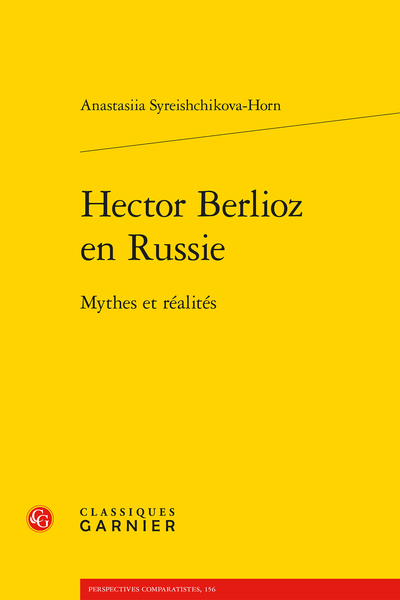
Hector Berlioz en Russie. Mythes et réalités
Classiques Garnier, Perspectives comparatistes, n°156, 2026, 410p.
ISBN : 978-2-406-19084-4
Grâce à un corpus des sources russes inédites, cette étude documentée met à l’épreuve de l’histoire la légende du triomphe de Berlioz en Russie lors de ses deux tournées de concerts. Il s’agit d’éclairer la complexité des échanges artistiques franco-russes au XIXe siècle, entre mythe et réalité historique.
> Pour plus d’informations sur cet ouvrage
 Aude Briau, Dominique Allart et Antonio Geremicca
Aude Briau, Dominique Allart et Antonio GeremiccaCollections artistiques de l’Université de Liège, La collection d’arts graphiques anciens du Musée Wittert, 2025, 192p.
ISBN : 978-2-930930-02-2
A partir des collections d’estampes anciennes du Musée Wittert, l’ouvrage fait état de la formidable diffusion que connurent les gravures de l’artiste colmarien Martin Schongauer (vers 1440/1445-1491) au début des Temps modernes. Il y est question du caractère novateur de l’art de Martin Schongauer, de l’utilisation de ses estampes comme répertoire de modèles pour les artistes, de l’arrivée de certaines d’entre elles à l’Université de Liège via le legs du baron Adrien Wittert (1823-1903), mais aussi plus spécifiquement de trois œuvres célèbres de Schongauer, Saint Antoine tourmenté par les démons, Le Grand Portement de Croix et Saint Sébastien qui inspirèrent durablement les graveurs.