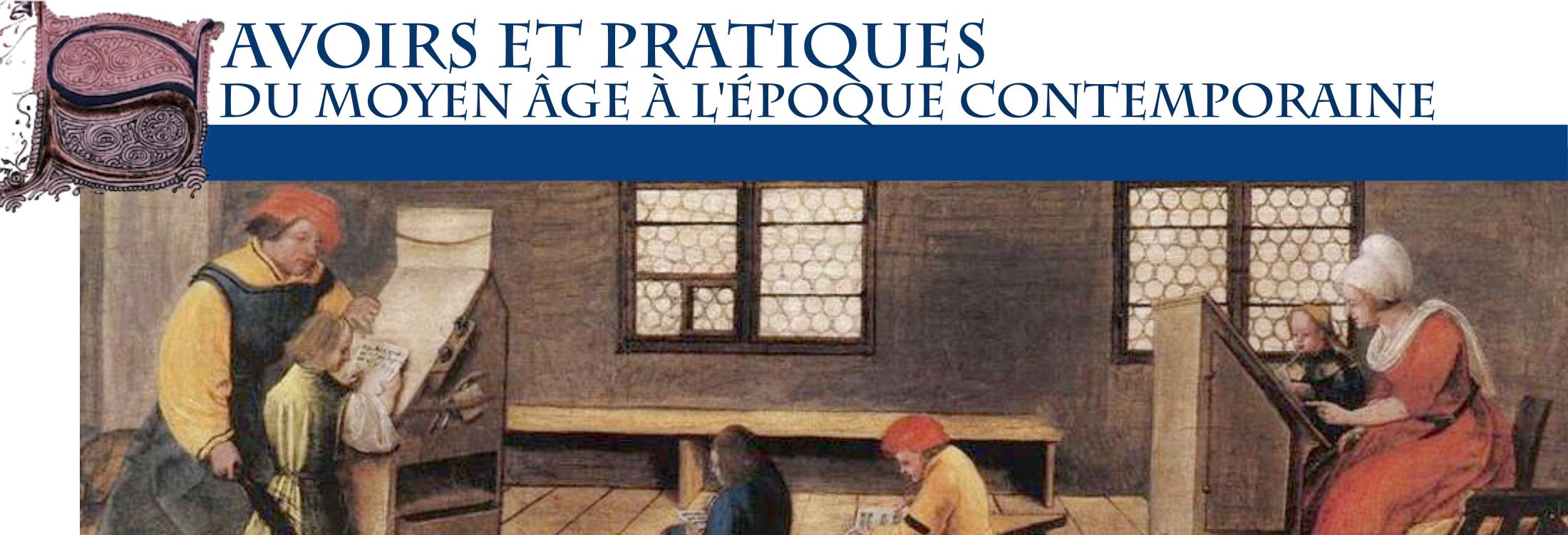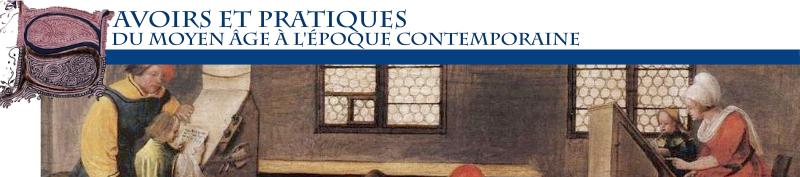Appel à communication
Journée d’études doctorales du laboratoire Saprat
Dans le cadre de la journée d’étude doctorale de l’unité Saprat, nous effectuons un appel à communication auprès des doctorants. Cette année, le thème retenu est celui de l’école, envisagée à la fois comme institution, comme mouvement de pensée et comme modalité de transmission du savoir.
Les propositions de communications, d’environ 1 500 signes, seront à faire parvenir à l’adresse jed.saprat@gmail.com au plus tard le 15 décembre 2025.
La journée d’études se déroulera le jeudi 2 avril 2026 à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) – 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris 6e.
>>> Pour télécharger l’appel à communication complet
Le terme école, du grec σχολή, renvoie depuis l’Antiquité à une réalité complexe à appréhender et riche de sens. Le grec σχολάζω induit l’idée d’épanouissement intellectuel, de loisir, mais également de communauté apprenante. Le terme latin correspondant, schŏla, conserve cette dimension de loisir studieux et désigne tout à la fois le temps que l’on consacre à l’étude et le lieu où l’on enseigne. Au Moyen Âge, cet héritage s’actualise selon des modalités diverses. On y voit émerger de hauts lieux de transmission du savoir, qu’il s’agisse de scriptoria ou d’écoles monastiques qui enseignent un savoir de pointe et assurent la conservation et la diffusion des textes. Dans les territoires de l’Islam, la terminologie de l’école connaît également des variations. À partir du XIe siècle, la madrasa (madāris) s’impose en Orient comme institution d’enseignement supérieur consacrée principalement aux sciences religieuses et juridiques. Dans l’Occident musulman, cette fonction de transmission savante peut aussi être assumée par des structures d’un autre type, comme la zāwiya (zawāyā), liée aux confréries soufies, qui combine formation spirituelle, enseignement, hospitalité et ancrage communautaire – une réalité institutionnelle qui n’est pas sans évoquer, par certains aspects, les formes monastiques du Moyen Âge chrétien.
Mais l’école est également un lieu où se façonne le savoir méthodologique et pédagogique : que l’on pense à la manière dont la scolastique médiévale redessine les contours de la logique aristotélicienne, ou au rôle joué par Porphyre dans la transmission de l’héritage néo-platonicien. L’école, comme institution, connaît également, au tournant du XIe siècle, d’importants bouleversements, et devient le lieu concret de mutualisation d’un savoir pluriel, à l’instar de l’École de Chartres, souvent étudiée pour le rôle qu’elle a pu jouer dans la mise en rapport du patrimoine mathématique et naturel antique avec une théologie scolaire.
Le terme d’école doit également être entendu comme espace – matérialisé ou non – de transmission d’un savoir-faire technique, un lieu où s’enseigne le geste, le procédé, par-delà le savoir théorique. Qu’il s’agisse d’ateliers de peintres ou de copistes, d’orfèvres ou de sculpteurs, ces espaces sont autant de lieux où émerge et perdure la transmission d’un savoir-faire qui entretient des liens complexes avec le savoir théorique figé par l’écrit. Cette acception du terme doit nous inviter à explorer les modalités de transmission du savoir-faire, entendu comme point de rencontre entre littérature technique et apprentissage pratique. Les traités techniques médiévaux, comme la Schedula diversarum artium, ainsi que les recueils de recettes techniques, telles que les Mappae clavicula, montrent que des savoirs de fabrication – pigments, liants, dorure, préparation des fonds – circulaient et pouvaient être consignés pour un usage pratique dans l’atelier.
Ces premiers jalons font ainsi émerger plusieurs questions : comment se définit donc une école, et qu’est-ce qui en fait une entité distincte ? Quels sont les critères d’appartenance à une école, et comment s’opèrent les filiations intellectuelles, artisanales ou pédagogiques ? Quelles relations l’école entretient-elle avec les normes et les institutions qui la reconnaissent ou qui la contestent ? Enfin, comment les savoirs se transmettent-ils dans les ateliers et quelles interactions peut-on identifier entre formation intellectuelle et formation pratique ?
Cette journée d’étude se veut un espace de réflexion ouvert aux doctorants de Saprat et d’autres institutions, leur offrant l’occasion d’interroger la notion d’école à partir de leur propre objet de recherche. Qu’il s’agisse d’étudier l’école comme courant de pensée, institution éducative ou atelier, les communications permettront d’explorer les multiples facettes de la transmission des savoirs à travers les siècles. Les candidats pourront proposer une contribution et mobiliser entre autres l’un des aspects suivants pour étayer la réflexion scientifique sur le thème proposé :
I. Lexicographie de l’école : les mots pour le dire
Observateur par définition, le scientifique s’attache à discerner des régularités dans le fonctionnement de son objet d’étude. Dans le domaine des sciences humaines, lorsque ces régularités prennent la forme de similitudes ou de convergences, elles sont souvent regroupées sous le terme d’école. Or, produit d’une observation rétrospective, ce terme n’est pas toujours neutre : appliqué à des expériences passées, il peut rassembler des praticiens ou des courants de pensée qui ne se revendiquent pas eux-mêmes d’une telle unité. Parfois même, employer la notion d’école revient à réinventer une réalité passée, en lui prêtant une cohérence qu’elle n’avait pas. Cet axe propose donc d’interroger le terme école sous un angle lexico-sémantique, afin d’en éclairer les usages actuels, mais aussi de repérer le vocabulaire mobilisé par les acteurs eux-mêmes pour nommer les mouvements intellectuels auxquels ils participaient : questionner la dénomination, c’est mieux comprendre la réalité historique.
II. Enseigner et transmettre, l’école comme héritage et tradition
L’école ne se réduit pas à un espace d’apprentissage : elle constitue aussi une mémoire collective, un conglomérat de savoirs et de pratiques transmis d’une génération à l’autre. À travers ses méthodes, ses idées, ses normes, l’école se présente comme un lieu où s’incarne la tradition. Toutefois, l’école est non seulement un lieu de continuité, mais aussi de réinterprétation, car chaque maître transmet ce qu’il a reçu tout en le transformant.
Cet axe invite à réfléchir aux mécanismes de l’héritage et de la tradition, ainsi qu’aux modalités visibles et invisibles de la circulation des savoirs. On pourra aussi examiner les tensions entre fidélité et innovation dans la transmission des connaissances, afin de penser l’école comme le vecteur d’une mémoire vivante, continuellement travaillée par le temps et par le changement.
III. L’école en son lieu
Cet axe interroge les espaces dans lesquels s’organise et se transmet le savoir. Il invite à examiner les modalités de transmission du savoir en ces lieux multiples : qu’il s’agisse de centres d’émulation à l’image de la cour du prince, d’institutions où se structure et se codifie le savoir académique, à l’instar de l’université ou bien d’espaces de formations pratiques, tels que les ateliers, les manufactures ou les académies.
IV. Construire l’école (de pensée)
Un lieu commun des discours savants consiste à postuler l’existence d’écoles ou de courants de pensée distincts en philosophie, en histoire, en peinture, en musique ou dans d’autres disciplines. Or, cette tendance à l’unification ne reflète-t-elle pas un biais, voire une exagération, en ce qu’elle occulte les fractures et les oppositions internes susceptibles de traverser une même école ? Cet axe invite par conséquent à réfléchir aux logiques internes de dissensus que le terme école tend peut-être à masquer, en raison de son caractère à la fois « vague et équivoque ».
V. Autorités, pouvoirs et contestations de l’École
L’école, dans toutes les acceptions du terme, est liée à la notion de « normes », dont elle est l’une des premières productrices. En effet, son existence et sa construction sont le fait d’une figure d’autorité tutélaire qui revêt de multiples formes (prince, mécène, maître, professeur, etc.) et permet son existence matérielle ainsi qu’intellectuelle. De ce fait, une forme de contrôle et de surveillance y est bien souvent imposée : dans sa forme institutionnelle, ses activités, son financement, son existence dépendent de ses bonnes relations avec l’autorité. Dans sa forme intellectuelle ou artistique, la condition de rattachement est le respect de normes, de règles communes. Si les normes imposées par la figure d’autorité sont la condition d’existence de l’école sur le plan institutionnel, artistique et culturel, elles sont également un carcan susceptible d’être contesté, ou même défié.
L’événement sera également l’occasion d’un échange interdisciplinaire, favorisant le dialogue entre différentes approches méthodologiques et historiographiques. Une publication des contributions sera envisagée afin de prolonger ces discussions et d’en valoriser les apports.
Comité d’organisation
Asel Akbanova, Antoine Altieri, Abdelhak Boumsied, Arthur Deconynck, Sixtine Haye, Élisabeth Heid, Orsola Pellino, Evguenia Timofeva.